Docteur en psychologie, ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, conseiller du président djiboutien, Chehem Watta a publié une dizaine de recueils de poésies et de nouvelles, principalement aux éditions L’Harmattan. Il a publié récemment, en juillet 2018, Testament du désert, puis, en novembre 2018, un recueil de poèmes Sur le fil ténu des départs (Ed. Dumerchez).
Dans un entretien réalisé à Djibouti-ville, Chehem Watta revient sur sa vie à Djibouti et à l’extérieur, sur l’écriture et la culture djiboutienne. Il nous livre ses pensées concernant la Corne de l’Afrique, les guerres et le rôle du poète en temps de crise, mais sa vision des relations entre la France et Djibouti.
Entretien
En quelques mots, peux-tu m’évoquer un lieu à Djibouti que tu apprécies et que tu ne retrouves qu’à Djibouti? Un lieu qui t’évoque un sentiment de nostalgie quand tu es à l’étranger, un lieu qui rend Djibouti unique à tes yeux ?
Il n’y a pas un lieu précis, mais il y a plusieurs lieux, à Djibouti-ville surtout. Djibouti-ville où je vis, où je travaille, où j’ai ma vie familiale, et ce lieu, ce sont des lieux où je nomadise pour écrire. Il n’y a pas forcément un seul endroit : ce sont souvent des cafés, un café comme celui où nous nous trouvons maintenant. Je nomadise de café en café. Ce café-là, cette année et l’année dernière en 2018, mais il y a eu l’hôtel Ali Sabieh, le café Rétro… Je vais dans ces endroits vraiment lorsqu’il y a peu de monde, souvent entre 14h et 17h, que je peux m’installer pour écrire, ou bien très tôt, le matin, avant que les amis ou les gens ne viennent s’y installer. Ce sont des lieux que j’apprécie vraiment à Djibouti-ville.
En dehors de Djibouti-ville, là, il n’y a vraiment qu’un seul lieu, c’est le lac Assal. Il y a, là-bas, un arbre tout seul, où je me rends très souvent pendant les weekends. J’y suis le plus souvent seul. Soit j’écris, soit je reste dans le silence, dans le silence du désert. Là, c’est un lieu mythique pour moi, pas loin de l’Ardoukôba, le volcan, et avec une vue panoramique sur le lac, mais du côté de la route qui traverse le Ghoubet. J’y vais avec une table pliante et souvent, je reste toute la journée. C’est là-bas que je trouve mon inspiration, et en même temps j’y trouve aussi l’apaisement nécessaire à l’écriture.
Ce sont un peu vos deux racines, à la fois les cafés, très français comme mode d’écriture et mode de vie, et en même temps, le lac Assal, qui renvoie à vos racines afares.
Disons que la fréquentation des cafés résulte de mon expérience d’universitaire à Paris. C’est à Paris que j’ai appris à travailler dans les cafés : quand les bibliothèques universitaires étaient fermées, surtout les dimanches, j’allais travailler dans les cafés. Mais même, avant de partir en France, j’avais aussi mes habitudes ici. Quant aux racines, j’ai des origines nomades. Il est tout à fait normal que je trouve cet endroit, le Lac Assal, à mon goût parce qu’effectivement on ne retrouve pas uniquement le décor, mais l’âme de la vie du nomade qui est souvent appelé à se retirer sur lui-même. L’écriture, c’est ça aussi, se parler à soi-même, se retrouver quelque part, puiser ses ressources dans les racines profondes, et vraiment, pour écrire, j’ai besoin de ça. C’est pour ça que je ne peux pas partir, quitter Djibouti. C’est le lieu de mes racines. Sincèrement, je suis très lié à la République de Djibouti. Quand j’écris, je ne suis ni Afar, ni Somali, je suis Djiboutien, fils de nomades. Mes références d’Afar ne me servent pas tant que ça, car je souhaite aller au-delà de mes origines ethniques pour m’encrer dans une littérature et une poésie qui dépassent toute la Corne de l’Afrique. D’ailleurs, dans mes livres, je ne parle pas uniquement que de Djibouti, je parle de toute la Corne de l’Afrique, qui est un berceau de tous les nomades et un immense réservoir de cultures et de diversités culturelles. Écrire là-dessus est une grande aventure intellectuelle, sociale et culturelle nécessaire pour pouvoir transformer nos pays et nos sociétés.
Tu parles d’aventure intellectuelle : toi, comment es-tu devenu poète ? Comment un jour, as-tu décidé de prendre la plume ?
Je dis souvent : c’est la séparation d’avec mon désert natal, d’avec les animaux et de ma vie de nomade qui a créé les conditions nécessaires à l’écriture. Cet espace que j’ai quitté très jeune pour aller à l’école, notamment à Tadjourah ville, a été pour moi un acte fondateur. A défaut de le retrouver physiquement, je l’ai imaginé. C’est un espace mental que j’ai toujours porté en moi, que ce soit ici ou ailleurs, quand je suis allé en France pour étudier, ou aux États-Unis lorsque j’y travaillais, ou encore au Rwanda ou au Burundi. Donc l’acte fondateur de ma poésie est cette séparation physique d’avec mon désert natal, et je vois toujours, quand j’écris, l’horizon comme image mentale. L’horizon aussi comme défi, car il faut absolument aller au-delà, marcher. La marche est très importante dans ma poésie, car effectivement, ce n’est pas le repos qui réduit la distance mais la marche. Si on veut atteindre nos objectifs, il faut marcher. Marcher, c’est travailler, marcher c’est avoir des liens, marcher c’est aussi dépasser nos conditions physiques et sociales pour pouvoir arriver à destination. Mais il n’y a aucune destination, car finalement, il faut toujours aller au-delà des étapes, au-delà des bivouacs, au delà des efforts.
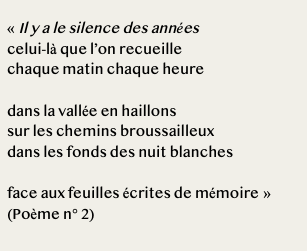
Tu avais déjà un peu répondu à cette question, mais où écrit-on de la poésie et des romans à Djibouti ?
Je pense qu’on écrit souvent chez soi, mais chez soi, c’est vaste et en même temps restreint. On a quand même des rapports sociaux qui sont très étroits avec les gens, donc si on te voit écrire dans un café, les gens vont venir s’installer avec toi, et tu n’es plus seul pour créer. A chaque fois, il faut trouver un espace, parce que créer, c’est être seul aussi, créer c’est être solitaire. Dans un groupe, tu ne peux pas créer à ta guise, alors généralement, il faut alterner les espaces. Il faut écrire à la maison, mais à la maison, il y a aussi les visiteurs qui viennent, il y a tout le réseau familial… Finalement, on écrit souvent la nuit. On écrit la nuit, ou bien je sais que certains vont s’isoler dans un hôtel quelque part. Partir, c’est ce que je fais pendant les vacances. Je pars au nord de l’Éthiopie. Là-bas, je ne risque pas de rencontrer des connaissances. Pour écrire à Djibouti, il faut vraiment beaucoup de résistance, de la résilience même, parce qu’on ne peut pas se couper du monde social dans lequel on vit. En même temps, on puise dans ces gens-là, dans leurs aventures, dans leur contact humain, c’est assez délicat. Écrire, c’est avoir une force mentale importante, une grande motivation car toutes les conditions ne sont pas réunies. Djibouti, c’est un pays à tradition orale : les gens adorent parler et souvent on ne met pas tout ça par écrit, donc l’écrit repousse un peu les gens, parce que, quelque part, écrire c’est quelque chose qui dure, qui est fixe.
Alors, qu’est-ce que cela veut dire être écrivain, être poète à Djibouti ? Qu’est-ce que cela représente pour la société locale, surtout dans un pays de tradition orale, où les gens sont parfois un peu méfiants lorsqu’ils voient quelqu’un écrire ?
C’est paradoxal. Le poète est non seulement accepté mais aussi valorisé car la tradition orale accorde une place fondamentale à la poésie. C’est valorisé socialement et culturellement. Un poète, c’est quelqu’un qui prend place dans la Cité, qui a toujours eu quelque chose à dire, et qui souvent, le dit à travers des critiques sociales, des éloges (de la chamelle, de la vache, du cheval, etc.) , à travers des pamphlets, des figures, des animaux comme une fable. C’est quelqu’un qui a déjà sa place dans une société. Maintenant, je crois que les premiers poètes qui ont commencé à écrire, ont écrit des pièces de théâtre. Quelle que soit la langue dans laquelle ils écrivent, on voit toujours de la poésie transparaître, et ensuite, si le poète décide d’écrire des livres, il y a une reconnaissance. Il est reconnu comme étant poète, comme étant quelqu’un qui participe à la vie intellectuelle du pays. Mais ça ne dépasse pas ce stade, parce que ses livres ne vont pas être achetés, parce que les gens ne lisent pas encore suffisamment. En revanche, quand on rencontre un poète, on va lui dire : « Bravo pour ce que vous faites ! » Il existe bien une reconnaissance sociale, indéniablement. Les Djiboutiens apprécient le poète, l’écrivain, tout simplement aussi parce que nous sommes aujourd’hui dans un monde de l’écriture : Internet, Facebook… Tout le monde voit maintenant ce que les poètes font. Quand on se balade en ville avec des amis qui viennent de l’extérieur, les gens font le lien : « Est-ce que c’est un cinéaste que vous avez emmené ? Est-ce que c’est un homme de théâtre ? ». Je crois que la production littéraire commence à être apprécié comme étant, non pas un artifice mais un élément de la création artistique et intellectuelle à Djibouti.
Ces poètes et écrivains sont de plus en plus acceptés, mais en parallèle, certains vivent de l’exil. Que peut-on dire de l’exil d’un poète ?
L’exil n’est pas forcément politique. Il y a des gens qui ont fait le choix de ne pas rester à Djibouti, qui ont décidé de partir à l’extérieur et d’écrire dans l’exil. J’ai toujours dit : lorsqu’on est exilé, que l’on est immigré dans un autre pays, on porte notre pays d’origine dans son ventre, c’est ce qui nous permet d’écrire. Ces écrivains sont peut-être séparés de leur pays physiquement mais jamais mentalement, donc ce qu’ils écrivent est peut-être plus fort, car il y a un manque, un appel de la mémoire, un appel de ce qui s’est passé. Il y a des gens qui ont pris la plume et qui veulent parler de leur pays, même s’ils l’ont quitté physiquement. Il y a Abdourahman Waberi qui écrit beaucoup, qui est d’ailleurs, peut-être, parmi les Djiboutiens exilés, le plus talentueux, parce qu’il porte ce pays dans sa tête, dans son ventre. Il y a eu récemment Rachid Hachi. Il était militaire Non seulement il s’est exilé, mais il publie aussi des Djiboutiens. C’est une dimension nouvelle qu’il a ajoutée à la littérature djiboutienne. La publication est en effet un goulot d’étranglement de la littérature djiboutienne. Trouver un éditeur, c’est compliqué. Rachid est en train de publier, depuis 2018, de jeunes auteurs qui ont prit la plume tout en restant à Djibouti.
A Djibouti, certains se sont aussi « exilés », dans la mesure où je parlais de la difficulté d’écrire. Il faut s’enfermer quelque part. Il faut prendre le silence comme allié. Il faut partir momentanément pour écrire. Il n’y a pas une contradiction entre l’exil et l’écriture, parce qu’il s’agit d’une position mentale, physique certainement. De temps en temps, on voit des gens qui reviennent ; ils n’écrivent pas, mais sur Facebook, ils prennent la parole, et il y a un mal-être. Je crois que ce mal-être est général dans la Corne de l’Afrique, qui est une région tourmentée, une région où il y a eu beaucoup de guerre, beaucoup de famine, où les gens ont ou ressentent de réelles difficultés. Tous ces bouleversements régionaux ont fait que beaucoup, sans le vouloir, se sont retrouvés jetés dans l’exil, sur les routes du monde, et on voit vraiment que l’exil a été un des moments créateurs qui a permis de propulser des talents, pas forcément djiboutiens, mais aussi des talents éthiopiens, somaliens, érythréens. Les conditions sont dures et plus la souffrance est forte, plus l’envie de prendre la plume et de partager cette souffrance est naturelle. Je pense que c’est la configuration de la région qui fait que les gens ont décidé d’écrire le chaos qu’ils ressentent en eux-mêmes, en quittant leur logement, leur foyer, la rivière qu’ils aimaient, les animaux qu’ils aimaient. Il y a un chaos qui s’est installé en eux, et ce chaos, il faut l’écrire, sinon on est perdu, on meurt. On ne peut pas rester muet autour de ce qu’il se passe.
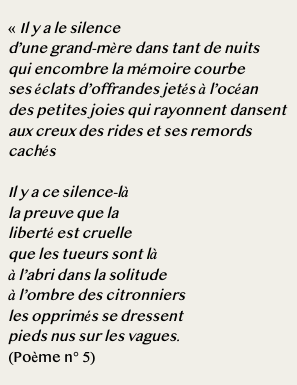
Il y a des talents qui se sont mis en valeur dans les États européens parce qu’ils ont une liberté d’expression plus accessible, ils ont aussi les maisons d’édition, il y a les critiques littéraires qui sont là-bas, il y les lecteurs… Quelque part, dans l’exil, on trouve des éléments objectifs, valorisant pour celui qui écrit.
A Djibouti, cela se met en place, petit à petit. Il n’y a pas beaucoup de lecteurs, et souvent, les seuls manuels que les gens ont lu sont les manuels scolaires. On voit petit à petit, grâce au ministère de l’Éducation, que des programmes sont mis en place autour des auteurs nationaux. Cela se met en place mais l’exil reste un thème littéraire qui intéresse beaucoup de gens. L’exil est un thème vraiment important pour moi. J’ai écrit un petit recueil de nouvelles qui s’appelle Amours Nomades : Bruxelles, Brumes et Brouillard. J’ai parlé de femmes qui se sont exilées, que j’ai interviewées à Djibouti ; certaines, je les ai retrouvées à Bruxelles.
Finalement, ces conditions difficiles de la région sont des conditions révélatrices des écrivains, de ceux et celles qui ont quelque chose à dire, à partager.
0.0.1.
La Corne de l’Afrique, en ce moment, c’est la guerre au Yémen, c’est l’éclatement de la Somalie, des frontières fermées qui commencent à s’ouvrir doucement avec l’Érythrée. Écrire au milieu des guerres et des réfugiés, est-ce possible ? Est-ce que le poète ou l’écrivain a un rôle à jouer pour la paix ?
C’est important. Il a un rôle à jouer. Il a une partition à jouer. Tout simplement, on ne peut pas se taire dans ce chaos, dans ces difficultés qui sont au-delà des frontières, parce qu‘effectivement, les gens sont inter-reliés. Les gens qui vivent à Djibouti vivent aussi en Érythrée, en Éthiopie, en Somalie, même au Kenya. Forcément, ce qui se passe dans cette région les affecte, pas seulement intellectuellement, mais socialement, culturellement et même affectivement. Tout cela nous affecte. Ce qui se passe dans cette région ne peut pas laisser les gens indifférents. On ne doit pas prendre position à la hâte, sans prendre du recul et de la distance pour porter des jugements sur des événements : on doit analyser lucidement ce qui se passe. Ça c’est le rôle des intellectuels. L’intellectuel doit avoir une démarche basée sur le doute et la distance. Il ne doit pas se précipiter dans le feu de l’action, s’aligner ici et maintenant ! Mais les intellectuels, dans ces affrontements souvent communautaires, n’ont pas une place prépondérante s’ils ne prennent pas fait et cause pour leur communauté. Les gens préfèrent des postions radicales. Cela reflète une crise identitaire majeure que l’on observe dans cette région. D’où l’importance d’être à l’écoute des populations et des projections qui doivent se faire pour l’avenir. Mais il y a un désengagement intellectuel pitoyable dans certains cas. Si bien que maintenant, sur ce qui se passe au Yémen, beaucoup de gens se taisent. A Djibouti, on a accueilli beaucoup de réfugiés yéménites. Nous n’avons pas été fermés à la souffrance du peuple yéménite, car il y a une partie des Djiboutiens qui sont d’origine yéménite. Il n’y a pas eu de discrimination vis-à-vis de ces populations et aujourd’hui, elles peuvent vivre dans n’importe quel quartier à Djibouti. Elles ne sont pas à la lisière de certains quartiers, elles sont maintenant au cœur de ces quartiers. Mais il n’y a pas suffisamment d’écrits sur cette guerre, surtout venant des Djiboutiens ou des gens venant de la région. Quand on a cette capacité ou cette position d’écrivain, on ne peut que témoigner, que dire ce que l’on ressent. Dans un de mes derniers livres, je parle du Yémen. Dans le Testament du désertet mon recueil de nouvelles « Rives, transes et Dérives. Errances en mer Rouge »j’évoque ces peuples, qui sont des peuples reliés. Tout à l’heure, je n’ai pas évoqué le Yémen dans la Corne de l’Afrique, mais il y a bien sûr, beaucoup de gens qui sont partis d’une rive à l’autre pour s’installer sur les côtes voisines. Les populations du Yémen, ce sont des populations qui ont des attaches culturelles avec nous. L’écrivain a des choses à dire là-dessus, sur cette guerre, mais il ne peut pas le faire sous forme de tweets, de messages. Son œuvre, pour qu’elle soit lue, qu’elle soit interprétée, il faut qu’elle soit disponible dans les langues comprises par les populations de la région. Moi, j’écris en français, d’autres en amharique, d’autres en anglais, en arabe, certains en somali, en afar, si bien que de temps en temps, on ne communique pas ensemble. Nos œuvres ne sont pas lues ou traduites comme nous le souhaiterions !
Si on ne s’allie pas entre États, si on ne voit pas ces frontières disparaître petit à petit, si on ne voit pas ces communautés dialoguer de nouveau, nous ne pouvons pas avancer durablement et construire une région fiable et prospère. On parle d’intégration régionale, mais il faut aussi parler de l’intégration mentale de toutes ces populations qui ont un fond culturel commun et qui, par les religions, ont appris à dialoguer et à se confronter depuis des siècles.
Finalement, nous devons aller au-delà des livres que l’on écrit : lancer et approfondir des débats, des échanges. On doit favoriser la création de ce que l’on pourrait appeler les États confédérés, les États-Unis de la Corne de l’Afrique. Sinon onva être complètement bouffé par les guerres et des luttes identitaires sans fin. On le sera aussi par cette mondialisation rampante, qui n’a pas que des gadgets. Chez nous, elle a pris la forme militaire, une mondialisation des bases militaires. On a toutes les bases réunies chez nous. C’est une très bonne chose, parce qu’on a une bonne position stratégique. Mais en même temps, on est sur le fil des risques, parce que ces pays n’ont pas forcément des intérêts convergents. C’est un risque, que pour l’instant, Djibouti a bien géré.
Si l’on regarde la Somalie, c’est un État qui, depuis trente ans, est en guerre, et qui se reconstruit petit à petit, malgré un morcellement. Or le morcellement paraît difficile à envisager si on veut coopérer et mettre en place des alliances, former des confédérations ou des fédérations. Il faut nous allier. L’intellectuel, le poète, l’écrivain, ils doivent être à l’avant-garde, car nos peuples souffrent énormément et nous représentons nos peuples.
On ne peut pas chanter l’éloge des ethnies, des communautés. Il faut maintenant dire : « ça suffit » si on veut aller au-delà. Je prends l’exemple de l’Amérique : la guerre civile américaine a été plus violente pour les Américains que les deux guerres mondiales. Il y a eu des massacres terribles, mais quand même cela a pu reconstituer la mémoire « rassemblée » d’un pays qui est sorti de la guerre d’indépendance, qui est sorti de la guerre civile pour devenir depuis longtemps une grande puissance où chaque État a sa place. Pourquoi pas nous ? Ce n’est pas parce que l’on souffre aujourd’hui que nous ne serons pas capable de relever les défis de demain. Les gens nous disent souvent : « Ce sont des pays de famine, de guerre. » Oui, mais l’Europe aussi l’a été. Combien de temps il a fallu pour que l’Europe se relève ? Et encore, on voit des nationalistes revenir, qui disent qu’ils veulent revenir à l’ancienne France, à l’ancienne Allemagne. Les problèmes sont réels mais je suis très optimiste.
Tu parlais des écrivains, poètes et intellectuels, des débats. Peux-tu évoquer, en quelques mots, la littérature à Djibouti, notamment via les « café littéraires » que tu organises ?
Ce n’est pas moi qui les organise. J’ai participé à la création de ces cafés littéraires, notamment avec Rachid Hachi, comme auteur. Mais l’initiative vient des jeunes qui l’ont prise. Nous l’avons encouragé. La responsabilité de l’écrivain dans un pays comme Djibouti n’est pas seulement d’écrire mais aussi de créer des conditions pour que d’autres écrivains, d’autres auteurs émergent. Plusieurs conditions doivent être réunies : il faut des écrivains, certes, qui ont une expérience et qui encouragent, il faut des lecteurs, il faut une relève, il faut des maisons d’éditions qui publient des livres. Dans ces cafés littéraires, qui sont mensuels, ouverts à tous, les gens viennent, parlent. Chaque fois, on présente une œuvre choisie par les personnes présentes. On discute autour de cette œuvre et ensuite on donne la parole à tous ceux qui sont là pour lire, poèmes, morceaux de phrases. Il faut habituer les gens à présenter ce qu’ils ont écrit, car nous, pendant longtemps, on a caché ce que l’on avait écrit. On avait peur du regard des autres. Ce café permet la promotion de la lecture en même temps que la promotion de jeunes écrivains. Là aussi, Facebook joue un rôle important : on peut voir directement des lives. C’est vraiment une bonne initiative. On a fêté le 18 janvier dernier l’anniversaire de ce café littéraire. Nous ne l’avons pas raté une seule fois. C’est une bonne performance.
Il y a aussi d’autres initiatives pour promouvoir la littéraire, comme la « Caravane du livre ». C’est une association qui regroupe des amoureux de la lecture et de la littérature. Ils font des déplacements dans les quartiers, les régions, tout en effectuant des dons de livres à des bibliothèques. Ce sont de très bonnes initiatives, même si c’est très prenant, je pense qu’il y a un engouement certain pour la littérature djiboutienne et on souhaiterait qu’elle se développe dans les langues nationales, notamment afare et somalie. Cela donnerait à beaucoup de personnes la possibilité de s’exprimer dans leur propre langue. Cela va venir, mais pour l’instant, ce sont de très bonnes initiatives que j’encourage personnellement.
Concernant la littérature, peux-tu me parler d’une œuvre qui t’a marqué ?
L’œuvre qui m’a le plus marqué, c’est l’œuvre de Rimbaud. Je suis un rimbaldien de longue date et je pense que je resterai toujours proche de son œuvre, pas parce que simplement c’est une œuvre qui est universelle, qui parle à tout le monde, mais surtout parce que son expérience dans la Corne de l’Afrique nous l’a rapproché énormément en tant qu’homme simple, qui a marché, qui a côtoyé les gens de cette région. Après, il a y bien sûr les œuvres de Baudelaire, des auteurs comme Victor Hugo, Lamartine, que j’ai lu très jeune et qui ont laissé des traces importantes dans ma mémoire de fils de nomade, qui a eu accès à cette littérature grâce à l’école française laïque. Je dois mentionner les œuvres d’Aimé Césaire, d’Edouard Glissant que j’aime énormément aussi.
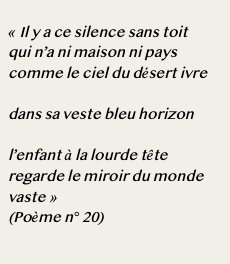
Extrait du recueil de poèmes
Sur le fil ténu des départs
Je rencontre des Français qui vivent à Djibouti, expatriés, volontaires qui sont là pour un an, deux ans. Je discute parfois avec eux et ces Français me disent souvent cette critique : « A Djibouti, il n’y a pas de culture ».
Alors là, ils sont complètement à côté de la plaque. Je te le dis sincèrement. C’est un pays où la culture est vivante. Il suffit d’aller voir des mariages et on voit l’étalage de la culture. Il suffit d’écouter la musique, c’est une culture fondamentale, poétique avec des jeux de mots ! Il suffit de voir aussi les gens qui se baladent parce qu’ils portent cette culture, les couleurs, les tissus. Peut-être qu’ils ne sont pas sensibles à cette culture du nomade ou d’un pays qui s’urbanise. Mais je crois que, ce qui a beaucoup changé, c’est le contact entre Français et Djiboutiens. Ce qui est fondamental, c’est que petit à petit, il y a eu une dissolution de ces contacts. Les Français se regroupent entre eux et les Djiboutiens ne voient pas, avec cet environnement qui change, les Français comme des acteurs privilégiés de la culture. Et pourtant, on voit que les Djiboutiens vont écouter France 24, ils vont regarder le journal d’Antenne 2, TV5. Mais petit à petit, il y a une rupture des liens culturels. Quand les politiques se rencontrent, ils se rappellent, juste pour se rafraîchir la mémoire, que nous avons des liens historiques. Mais ces liens commencent à se distancier et je vois que, de plus en plus, les Français se retirent dans les casernes, au Plateau du serpent, ce qui n’était pas le cas avant. Les militaires vivaient en ville, avec leur famille. Ils habitaient dans des logements loués à des Djiboutiens, tu les retrouvais dans les restaurants… Je crois que la forme de cette coopération a beaucoup changé et le regard qu’ils portent aujourd’hui, c’est un regard plus distant, même méfiant, parce que les Djiboutiens ont aussi évolué et regardent leurs parcours de manière plus novatrice.
C’est à la fois triste mais en même temps naturel. Toi et moi, nous parlons dans cette langue française, pas très valorisée par les Français eux-mêmes. Si tu te demandes comment on investit dans la Francophonie : on n’y investit plus. Je dirai qu’en 1995-1996, la coopération française était très forte à Djibouti. Ce n’est pas parce qu’ils avaient beaucoup de moyens ; ils faisaient avec peu de moyens des choses intéressantes. Ce n’est plus le cas. Maintenant, je pense qu’il y a aussi du côté de Djibouti des intérêts différents, mais quand les Français disent qu’il n’y a pas de culture, ça se voit qu’il n’y a pas de vrai dialogue entre ces deux communautés. Les Français sortent énormément, mais le tourisme, c’est aussi une culture. Quand ils voient le lac Assal, quand ils voient les nomades, ce n’est pas juste un paysage de cartes postales et de photos sur Facebook, ce sont des lieux culturels. On peut montrer à travers ces endroits des dialogues, mais malheureusement, de plus en plus, il n’existe plus d’espaces de rencontre entre Français et Djiboutiens. Bien-sûr il y a l’Institut Français de Djibouti qui se redynamise. Mais l’IFD doit aller de plus en plus vers les djiboutiens. Il doit organiser des activités dans les quartiers, dans les régions. Les débats et conférences organisés actuellement dans cette institution intéressent les djiboutiens et cela, je pense qu’il faut continuer à le faire.
Quand les gens partent en brousse, ceux qu’ils rencontrent ce sont des gens fiers, des gens qui ont gardé leur identité. Ça aussi c’est de la culture et on négocie, on discute, tout en préservant ces identités. Je crois que les Djiboutiens n’ont pas fondu dans la culture française, il n’y a pas eu cette fusion voulue. Les Djiboutiens ont continué de développer leur culture tout en incluant des pans de la culture française, que l’on voit surtout dans les milieux urbains, dans les écoles, dans les cinémas. Hier soir, j’ai participé à un débat en langue française. Cette langue est une langue qui nous lie et nous relie, mais elle commence à faiblir à Djibouti. Je pense que sur le plan politique, au-delà des discours de circonstances, il va falloir faire quelque chose. L’université est totalement djiboutienne… Là aussi, les Français peuvent venir faire des débats, des conférences, appuyer l’école doctorale, appuyer les instituts et les facultés. C’est à travers ces institutions que les cultures vont se développer, parce que la culture n’est pas quelque chose de figée. Ce passé qu’on a en commun, qu’en faisons-nous ? Je pense qu’il y a une distance qui se creuse, dangereusement et malheureusement ; pourtant nous avons encore beaucoup de chose à nous dire.
Il y a une dernière chose que je regrette sincèrement. En France, depuis les années 95, depuis la loi Pasqua, on voit que les étudiants africains, francophones en général, ont eu des accès limités aux universités françaises ou aux instituts. A cette époque, je travaillais aux États-Unis, à New-York. J’ai vu des jeunes Maliens, Togolais qui étaient diplômés des universités françaises venir en masse au Canada ou aux États-Unis. On les trouvait comme chauffeur de taxi le soir et le matin ils étudiaient l’anglais. C’était la première grande rupture du fil culturel. La deuxième rupture qui isole la culture française davantage, c’est cette question des quotas, l’augmentation des frais d’inscription. La culture, c’est quelque chose qui s’entre-tisse. Il n’y a pas une culture qui se développe en marge de toutes les autres, surtout dans un monde où tout est relié avec Internet. Cela va vraiment devenir une distanciation pour la culture française, pas seulement avec Djibouti, mais avec toute l’Afrique. Les parents qui envoient leurs enfants faire leurs études en France, c’est parce qu’ils croient encore au modèle culturel, pédagogique, intellectuel français. Mais en faisant des quotas, des gens comme moi, peuvent continuer à envoyer leurs enfants, mais d’autres qui travaillent et ne gagnent leur vie que pour les études de leurs enfants, cela va vraiment être un décrochage. Là, on ne parlera pas de rupture culturelle, on parlera de rupture tout court entre l’Afrique et la France. Tu n’ignores pas que l’avenir de la langue française, c’est surtout en Afrique. Mais comment on va pouvoir développer l’avenir de la langue, si on fait des restrictions sur la circulation des penseurs ou des gens qui créent en langue française ? Les étudiants, c’est aussi ça : une fois que les gens étudient dans un pays, ils ne viennent pas qu’avec la langue, ils viennent avec la culture du pays. Ils ont des amis là-bas, ils constituent vraiment des liens très forts, si bien que tout ça, petit à petit, avec un libéralisme exagéré, va se rompre.
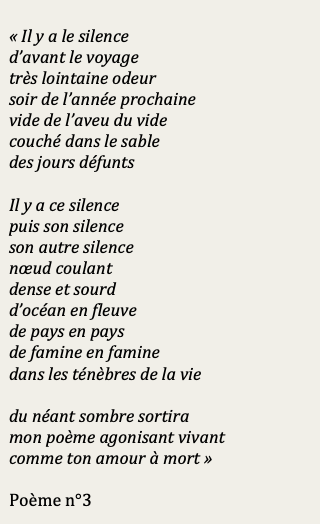
Pour répondre à ta question, il faut voir plus loin. Ce n’est pas quelques Français qui sont là qui doivent trouver du folklore. Il n’y a pas que du folklore djiboutien, il y a une culture, peut-être qui ne s’exprime pas comme en France, qu’il faut découvrir en étant lié à des Djiboutiens. Un exemple, comment les gens se parfument, comment les gens s’habillent, comment les femmes mettent en lien l’Orient, l’Afrique et l’Inde, ça ce sont des faits culturels. Et la cuisine ! La cuisine djiboutienne n’est pas une cuisine qui est tombée du ciel ; elle représente tout l’Océan Indien : on trouve des ingrédients, des senteurs et des couleurs de l’Océan Indien. Mais pour cela, il faut faire un effort, de part et d’autre, pour découvrir qui est qui et comment se structurent les cultures. Il faut parler des cultures dans cette partie de la Corne de l’Afrique, car elles sont multiples et à découvrir.

En compagnie de Jean-Dominique Penel (Historien de Djibouti).


djibouti le charme de la rudesse des pierres ,le charme des enfants du pays ,le charme du dénuement qui amène à à l’introspection à la profusion de pensées ,le charme de l’origine du monde …